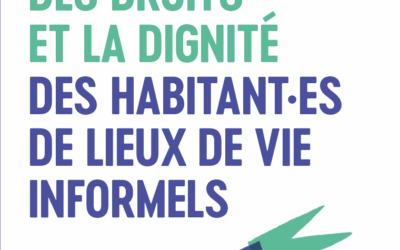Commémorations des internés Nomades de Rennes
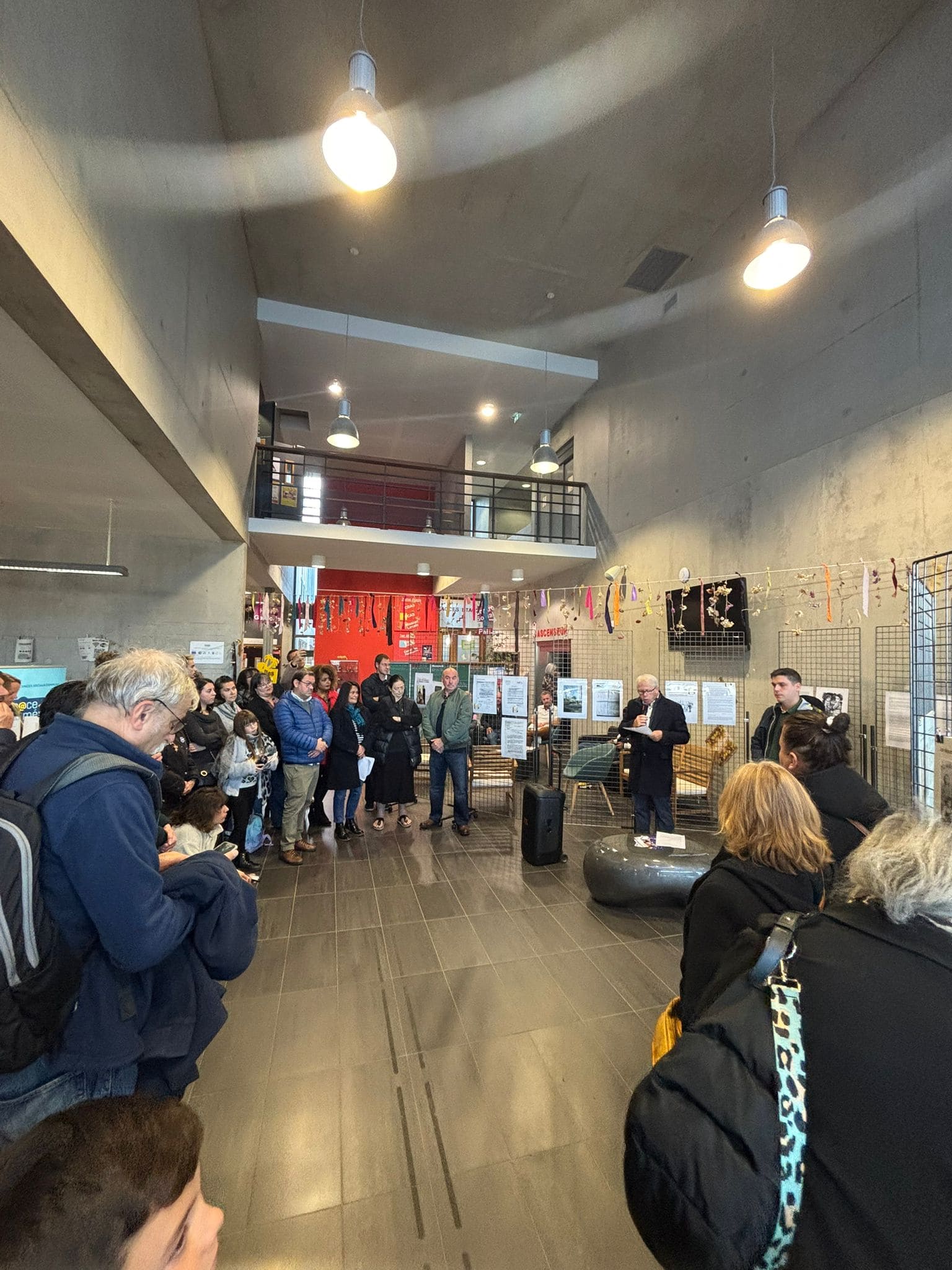
Rennes, 12 novembre 2025. – Alors que la France rend hommage, chaque 11 novembre, à la fin de la Première Guerre mondiale, une autre mémoire s’invite ce mercredi 12 à Rennes : celle du camp d’internement des “nomades”, où plusieurs centaines de familles tsiganes furent emprisonnées entre 1941 et 1944.
Organisée par l’Association nationale des Gens du voyage citoyens (ANGVC) et Association Gens du Voyage 35 (AGV35), la cérémonie se tient à partir de 10h15 sur le site de l’Espace socio-culturel des Champs-Manceaux, face à l’ancien emplacement du camp. Élus, associations et descendants d’internés y rendent hommage aux quelque 400 hommes, femmes et enfants enfermés là durant l’Occupation, au seul motif de leur appartenance au peuple tsigane.
Implanté au sud de la ville, à l’angle de la rue Le Guen de Kérangal et du chemin de ronde (actuel boulevard Albert Ier), le camp fut créé à la demande des autorités allemandes, après le décret du 4 avril 1940 ordonnant l’assignation à résidence des “nomades”. Entouré de barbelés, gardé jour et nuit, il a vu passer plus de 400 personnes dans des conditions d’hygiène et de vie effroyables, comme en témoignent les lettres conservées au Musée de Bretagne.
Bien que Rennes ait été libérée dès août 1944, le camp ne ferma qu’en décembre. Son existence est longtemps restée oubliée, jusqu’aux recherches menées dans les années 1980 par Arlette Dolo, dont le mémoire universitaire révéla l’histoire de ce “camp de la honte”.
Une plaque commémorative, inaugurée en 2013, rappelle aujourd’hui cette page sombre au 12 rue des Frères Louis et René Moine. Le camp de Rennes fait partie des quatre camps d’internement de nomades recensés en Bretagne pendant l’Occupation, aux côtés de ceux de Plénée-Jugon, Pontivy et Coray.
En rappelant cette histoire, la cérémonie du 12 novembre invite à reconnaître une mémoire longtemps invisibilisée, celle de citoyens français frappés par une politique d’exception raciale, dont les effets continuent de marquer les consciences.

Le 12 novembre 2025
Commémoration de la libération du camp pour Nomades de Rennes.
10h40 – Ouverture de cérémonie
Discours de Monsieur Honoré Puil, Vice-président de la métropole de Rennes, délégué au logement, à l’habitat et aux Gens du voyage.
Discours de Dominique Raimbourg, Président de la commission nationale consultative des Gens du Voyage (Excusé)
Discours de William Acker, délégué général de l’Association Nationale des Gens du Voyage Citoyens
Lecture de témoignages
Par Laurent Martin, délégué ANGVC Ille-et-Vilaine et Christophe Sauvé, membre de l’ADGVC44
Marche vers la plaque commémorative
Dépôt des gerbes de fleurs
Minute de silence
Déplacement vers le site du camp
Lecture des noms des interné.e.s
Pot partagé à l’ESC


Vous retrouverez ci-dessous le discours lu et écrit par William Acker, délégué général de l’ANGVC ce 12 novembre 2025.
Mesdames, Messieurs,
Chers élus,
Chers amis,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer la libération du camp d’internement des Nomades de Rennes.
Mais ne nous y trompons pas : si ce lieu fut libéré en décembre 1944, la plupart des familles internées ne le furent pas. Beaucoup sont transférées à l’été vers d’autres camps, notamment celui de Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire. Elles poursuivent ensuite leur parcours d’interné jusqu’en 1946.
Ce que nous honorons ici, c’est moins une libération qu’une mémoire : celle d’un enfermement oublié, d’une blessure encore vive dans l’histoire de notre pays.
L’internement des Nomades demeure en effet un fait largement méconnu du grand public.
Et pourtant, il s’agit d’une tache indélébile sur la mémoire nationale.
Les persécutions antitsiganes ne surgissent pas de nulle part. Elles s’enracinent dans une très longue suite de rejet et de stigmatisation, une histoire européenne d’abord, fait de persécutions et d’esclavage sur plusieurs siècles, qui prend racine dans l’empire byzantin et qui n’a jamais totalement disparu. Si nos familles sont présentes en France depuis au moins 6OO ans, c’est au XVII siècle que l’hostilité prend un tournant légal. Ainsi en 1682, sous Colbert, l’ordonnance dite « des Bohêmes » — trois ans avant le Code noir — condamne les « Bohémiens » aux galères, leurs femmes à la tonte, à l’enfermement dans les hospices, et leurs enfants à être élevés comme des orphelins. Cette représsion vise à répondre aux délits desquels sont accusés les bohémiens : vagabondage, la réunion dans un lieu, la mendicité, la bonne aventure, le travail avec des armes, mais aussi la magie, la sorcellerie, et le vol.
Voici donc la première tentative d’effacement.
Tout au long du XVIIIᵉ et du XIXe siècle, la presse et les pouvoirs politiques instrumentalisent la présence de ces familles pour répondre aux tourments d’une société en crise. Coupables idéales, car n’ayant pas voix au chapitre, elles sont présentées comme un peuple errant, asocial et dangereux — notamment en temps de guerre, en raison de leur mobilité.
Les stéréotypes antitsiganes se renforcent, en miroir des préjugés antisémites, car le « Tsigane » est aussi pensé à partir du « Juif ». Des penseurs de la race vont dessiner les grandes lignes de la pensée antitsigane. Celui qu’on appelle alors « Bohémien », « Romanichel » ou « Tsigane » est décrit comme un fléau des campagnes, un voleur inné, un propagateur d’épidémies, un homme sans terre ni nation, un parasite social.
Ainsi naît l’image du « Tsigane », qui colle encore aujourd’hui à la peau de celles et ceux qu’on appelle « gens du voyage », peu importe qu’ils ne se reconnaissent pas dans ces termes, peu importe qu’ils soient Gitans, Manouches, Sinté, Yéniches, Roms ou Voyageurs.
En 1912, la France passe un autre cap dans la rationalisation du traitement du « problème bohémien », et crée un véritable statut ethnique : celui des « Nomades ».
Il ne s’agit pas d’une catégorie sociale, mais d’une classification raciale : selon les textes en vigueur, toutes les personnes « de type bohémien ou romanichel » sont concernées. Ce statut s’accompagne d’un fichage systématique, d’un contrôle policier et d’une répression administrative. Enfermant le « Nomade » dans un statut de sous-citoyen.
Dès 1914, une première phase d’internement s’ouvre : les « Romanichels d’Alsace-Lorraine » sont enfermés au camp de Crest, dans la Drôme, jusqu’en 1919. Pendant ce temps, leurs cousins combattent dans les tranchées pour la Patrie, devenant ainsi, le temps d’un conflit, des Français presque comme les autres.
La répression reprend en 1939 : les premières mesures d’assignation à résidence, véritables formes d’encampement, visent les familles nomades.
Le 6 avril 1940, sous la IIIᵉ République, un décret interdit sur tout le territoire la circulation des Nomades et étend ces assignations.
Puis, sous le régime de Vichy, la répression devient systématique.
À partir d’octobre 1940, des camps spécifiques sont ouverts, en zone occupée comme en zone libre. Des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants y sont enfermés — souvent en famille.
Ils y subissent la faim, les violences, les spoliations, les placements forcés d’enfants, le travail obligatoire.
Au même moment, dans les territoires du Reich, se déroule le génocide des Roms, Sinté, Yéniches, Gitans et Voyageurs, tous regroupés par les nazis sous un même statut racial : celui de « Tsigane ».
Voici donc la deuxième tentative d’effacement.
Si la France n’a pas organisé de déportation systématique, plusieurs centaines de personnes furent raflées dans le nord du pays et déportées par les convois « Z » vers les camps d’extermination.
D’autres furent transférées directement depuis les camps français — Poitiers, Fort Barreau, Rivesaltes, et bien sûr Montreuil-Bellay.
En 2016, le président François Hollande a reconnu la responsabilité de la France dans l’internement des Nomades.
Ce fut un pas important, mais une reconnaissance encore partielle : la France n’a jamais pleinement admis l’ampleur des mauvais traitements, ni son rôle dans le génocide.
Aucune réparation n’a été engagée, notamment pour les spoliations.
Et notre pays demeure l’un des derniers États européens à ne pas reconnaître officiellement la date du 2 août, journée de commémoration du génocide des Roms et des Sinté.
Le camp d’internement de Rennes fut ouvert en novembre 1940, sur ordre de l’occupant allemand et sous l’autorité du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Situé rue Le Guen de Kérangal, dans le quartier du Pigeon Blanc, il enferma jusqu’à 200 hommes, femmes et enfants.
Leur seul « crime » : être perçus comme « Nomades », par leur origine, leur prétendue race ou leur mode de vie.
Le camp demeura actif jusqu’en décembre 1944, après la Libération de Rennes.
Longtemps oublié, ce lieu fut réhabilité en 2012 grâce à l’initiative du MRAP d’Ille-et-Vilaine, de l’Association des Gens du Voyage 35 et des élèves du lycée Chateaubriand.
Grâce à eux, une plaque commémorative rappelle aujourd’hui ce passé occulté.
Huit décennies plus tard, nul ne sait combien de personnes dites « Nomades » furent internées, déportées, mais également exécutées sommairement lors de l’épuration de 1944, notamment en Auvergne.
Les estimations les plus prudentes évoquent au moins 6 500 personnes intérnées.
En 2020, Henriette Théodore, ancienne internée ayant subie des spoliations, engagea un procès contre l’État pour obtenir réparation.
Le Conseil d’État déclara ne pouvoir agir : le décret du 5 janvier 2004 ouvrant réparation ne vise que les spoliations antisémites.
Ainsi, l’œuvre mémorielle s’inscrit dans une quête de justice encore inachevée, à l’heure où disparaissent les derniers survivants.
Mais cette mémoire vit encore : en janvier prochain, un projet de résolution transpartisanne sera déposé à l’Assemblée nationale, pour la reconnaissance officielle du génocide des Roms, Sinté, Yéniches et Voyageurs. En 2027 un nouveau mémorial devrait voir le jour sur l’ancien site du camp de Montreuil Bellay dans le Maine et Loire.
L’année 2026 marquera les 80 ans de la fin du régime d’internement.
Les derniers « Nomades » furent libérés du camp d’Angoulême à l’été 1946 — jetés dehors sans ressources, sans logement, sans réparation. Comme les autres, ils ont du se battre pour retrouver leur dignité. Certains ont perdu plus que des proches, l’effacement a fait son office, jusqu’à la perte de repères, et pour certaines familles de leur propre langue, le romanès, le yéniche, ou encore le manouche.
Des familles entières ont lutté pour retrouver la dignité qu’on leur avait enlevé, pour beaucoup cela s’est traduit par un retour sur le Voyage, une perpétuation d’un mode de vie ancestral qu’aujourd’hui encore bien des personnes peinent à comprendre. Pourquoi voyagez-vous, pourquoi continuez-vous à vivre dans des caravanes ? Pourquoi vous obstinez-vous à poursuivre ce mode de vie qui n’est pas adapté à la modernité, qui va à rebours de l’évolution et de la civilisation ?
Ces questions je les entends chaque jour.
Messieurs, Dames, tout ceci vous ne pouvez le comprendre sans entendre notre histoire, qui est aussi la vôtre. Poursuivre la vie dont nous avons hérité est un combat de chaque jour, pour la dignité humaine. Si la France est capable de comprendre chez les autres ce qu’elle qualifie de peuple autochtone, elle semble pourtant incapable de voir ceux qui vivent sur son propre territoire. Les Voyageurs portent un héritage culturel séculaire, qui est une part de notre héritage régional, ici en Bretagne, mais aussi national et européen.
Pourtant l’antitsiganisme reste aussi fort qu’il y a 80 ans, les discours politiques sont toujours hostiles, les gouvernements se succèdent et proposent toujours plus de répression, les Voyageurs continuent de subir des discriminations dans l’accès au travail, à l’habitat, à la santé. Pour certains parqués dans des aires d’accueil trop souvent à l’écart et polluées. Les Voyageurs sont bien souvent considérés comme des intrus, des envahisseurs, pourtant ils sont des habitants. Ils n’ont jamais rien été d’autre. Des habitants, attachés à leurs villes, à leurs régions, des bretons, des picards, des basques, des corses, des alsaciens, des Parisiens, des vendéens, des montagnards, des gens de mer, des habitants comme les autres, qui dans leur mode de vie ont gardé une part d’itinérance.
Ils vivent à Rennes, certaines familles sont ici depuis plus de 3 siècles et sont pourtant encore appelés accueillis. Pourtant ce sont bien des habitants.
Ils sont artisans, vendeurs ambulants, forains, ouvriers agricoles, conducteurs d’engin, routiers, éleveurs de chevaux, salariés, étudiants, actifs ou chômeurs. Ils sont engagés dans la vie locale, leurs enfants fréquentent les mêmes écoles que les vôtres. Ils sont civils et militaires, ils ont servi la France lors de chaque conflit, dans l’armée régulière et dans la résistance. Derrière l’étiquette administrative de « gens du voyage » coexistent une infinité de réalités, de trajectoires, de rêves et d’aspirations, de pensées, lumineuses ou sombres et de manières d’être, aussi nombreuses que les individus qui la composent. Derrière l’appellation il y a des ados en rébellions, des personnes désillusionnées, de gens heureux et malheureux, certains qui aiment le catch, d’autre lire Albert Camus. Il y a des conservateurs, des racistes, des misogynes, des féministes, des progressistes, des anarchistes, des tenants de l’ordre libéral, des admirateurs du capitalisme, des utopistes, des ignorants et des savants. Tous sont là. Un ethos c’est sûr, une sociologie c’est aussi certain, mais une infinité de dérivées.
Les Voyageurs sont des citoyens comme les autres.
L’histoire du camp de Rennes et la mémoire de nos anciens doit nous permettre de nous en rappeler.
Souvenons-nous d’eux, aujourd’hui, à Rennes.
Souvenons-nous pour qu’aucune mémoire ne soit laissée dans l’ombre.
Souvenons-nous, non pas pour rouvrir les plaies du passé, mais pour qu’enfin la justice et la reconnaissance viennent les refermer.
Je parlais en début de ce discours d’une tache indélébile sur la mémoire nationale. Un grand pays doit être capable de regarder cette tâche, de la comprendre, de la reconnaitre et de grandir à partir de son souvenir.